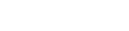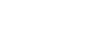Romain
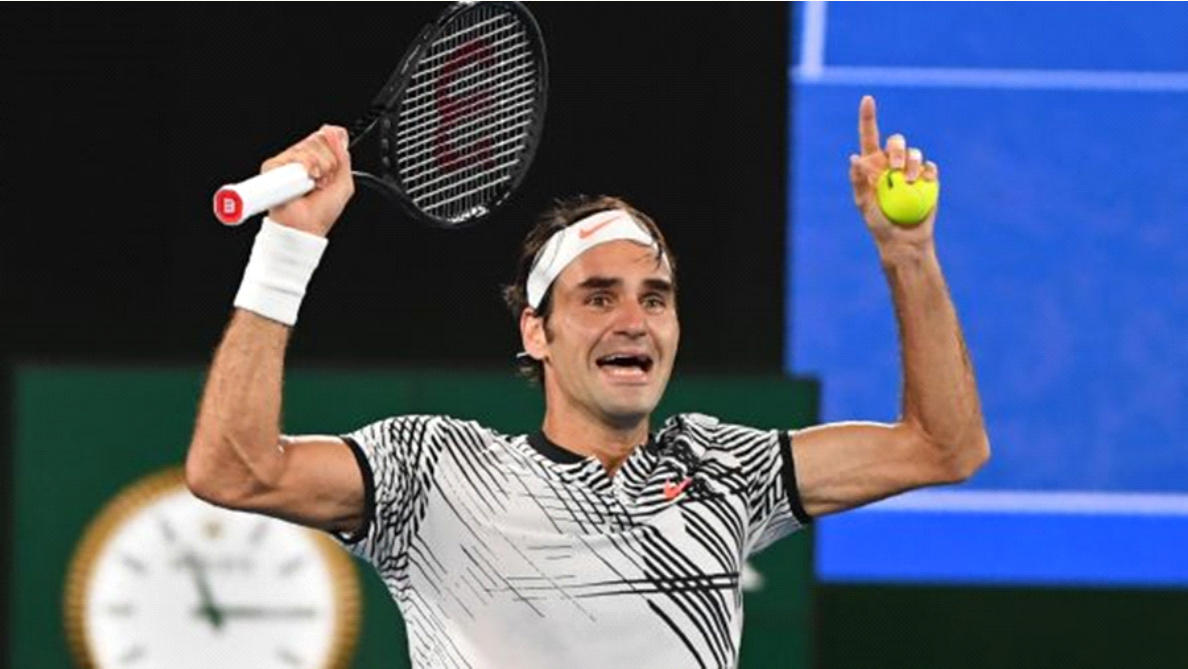

Romain
travaille
maintenant
dans
une
entrepris
d’informatique
jeune
et
flexible
qui
développe
des
applications
spécifiques
à
la
demande
des
clients.
Gagner,
tel
est
son
but,
et
pour
cela
il
s’inspire
de
la
volonté
farouche
de
ses idoles, les champions de tennis.
Laissons lui la parole !
La culture de la gagne


Nous
sommes
le
dimanche
19
Janvier
2017
à
Melbourne.
La
Rod
Laver
Arena
-
du
nom
du
seul
homme
de
l’histoire
du
tennis
à
avoir
réalisé
deux
fois
le
grand
chelem
dans
sa
carrière,
dont
une
fois
en
1962
où
il
a
aussi
gagné
la
coupe
Davis,
s’il
vous
plaît
–
est
pleine
à
craquer.
15
000
personnes
en
physique,
et
le
reste
des
fans
de
tennis
derrière
leur
télévision,
applaudissent
et
s’époumonent
pour
soutenir
les
deux
géants du tennis qui s’apprêtent à s’affronter.
D’un
côté,
Rafael
Nadal,
14
fois
gagnant
d’un
tournoi
du
grand
chelem
(à
l’époque).
El
Toro,
de
son
surnom
dû
à
son
style
de
jeu
tout
en
puissance,
a
alors
30
ans.
Il
a
gagné
son
premier
tournoi
du
grand
chelem
à
tout
juste
18
ans,
à
Roland-Garros,
son
terrain
de
prédilection.
Autant
dire
que
la
compétition,
il connaît.
De
l’autre
côté,
Roger
Federer,
dit
El
Maestro,
avec
17
titres
majeurs
à
l’époque
(le
record
en
date
en
Janvier
2017).
Roger
vient
d’une
autre
école
de
tennis,
celle
de
la
classe
et
de
l’élégance.
Les
déplacements
sont
fluides,
tous
les
gestes
semblent
simples
et
naturels.
Tout
est
«
facile
»
avec
lui,
mais
terriblement efficace.
Roger
Federer
et
Rafael
Nadal
ont
l’habitude
de
se
croiser
sur
les
courts
de
tennis,
et
très
souvent
en
finale
(38
rencontres
en
simple
jusqu’à
présent
pour
être
précis).
Mais
en
ce
19
Janvier
2017,
la
finale
de
l’Open
d’Australie
a
une
saveur
particulière.
C’est
un
mélange
de
mélancolie
avec
le
grand
retour
de
deux
immenses
stars
de
ce
sport,
mais
aussi
et
surtout
d’admiration.
Après
toutes
les
épreuves
physiques
et
donc
morales
qu’ils
ont
subies,
revoir
les
meilleurs
rivaux
se
retrouver
à
ce
niveau
de
jeu
avait
quelque
chose
de
magique
et
de
très
palpitant.
Digne
d’un
scénario
de
film
hollywoodien
certains
diront.
Nadal
revenait
de
4
mois
de
convalescence
et
Federer
6
mois,
autant
dire
une
éternité
dans
le
sport
à
haut
niveau.
Nadal
a
dû
soigner
ses
genoux
et
son
poignet,
très
abîmés
par
son
style
de
jeu
assez
brutal
parfois.
Federer
a
lui
soigné
ses
problèmes
de
dos
qui
devenaient
trop
récurrents.
A
35
ans,
et
avec
la
longue
carrière
qu’il
avait
derrière
lui,
on
peut
comprendre
qu’il
devienne
difficile
d’assumer
de
jouer
à
ce
niveau-là.
D’ailleurs,
la
plupart
des
fans
de
tennis
les
avaient
un
peu
enterrés
ces
deux-là.
Durant
leur
absence
des
courts,
de
jeunes
talents
avaient
émergés
aux
yeux
des
spectateurs.
On
sentait
la
relève
arriver.
Mais
les
papis
ont
fait
de
la
résistance
et
ont
montré
à
tous
ces
garnements
qui
étaient
les
vrais
patrons.
Cette
finale
de
l’Open
d’Australie
était
superbe
à
regarder,
que
l’on
s’y
connaisse
en
tennis
ou
non.
Un
match
en
5
sets
où
les
deux
combattants
se
sont
rendus
coup
pour
coup
:
Federer
gagne
le
1
er
set,
Nadal
le
2
nd
,
Federer
le
3
e
…
Enfin,
après
une
dernière
manche
pleine
de
rebondissements,
la
victoire
de
mon
idole
du
tennis
:
Roger
Federer
(pardon
Nadal).
J’ai
ressenti
une
grande
émotion
à
voir
cet
homme
gagner
cette
finale.
Il
venait
de
rappeler
qu’avec
beaucoup
de
travail
et
de
persévérance,
il
pouvait
encore
gagner.
Et
il
en
va
de
même
pour
Nadal.
Les
deux
tennismen
ont
prouvé
leur
valeur
tout
au
long
de
l’année
:
ils
ont
gagné
à
eux
deux
les
4
tournois
du
grand
chelem,
2
chacun
(Nadal
réalisant
la
prouesse de gagner 10 fois Roland-Garros).
Nadal
et
Federer
ont
donné
une
leçon
de
sport
et
de
vie
cette
année.
Ils
ont
travaillé
chacun
de
leurs
matchs
et
sont
rentrés
dedans
avec
la
conviction
qu’ils
pouvaient
gagner
et
non
pas
avec
des
doutes.
Leur
classement
mondial
parle
désormais
pour
eux
:
avec
leurs
absences
pour
blessure,
Nadal
était
redescendu
9
e
mondial
et
Federer
17
e
fin
2016.
Ils
sont
maintenant
respectivement
1
er
et
2
e
.
Pas
mal
pour
des
seniors
(sportivement
parlant.
Je
ne
voudrais
pas
froisser
mes
éventuels
lecteurs
qui
auraient
plus de 40 ans, et ils sont potentiellement nombreux dans la famille).
Le
doute
et
la
peur
de
perdre,
parlons
en
justement.
Car
à
l’inverse
des
prouesses
que
j’ai
évoqué
précédemment,
il
y
a
des
sportifs
dans
le
tennis
,et
même
malheureusement
dans
le
sport
en
général,
qui
sont
mondialement
connus
pour
les
contre-performances
:
les
français.
Dès
qu’on
les
retrouve
dans
des
rencontres
avec
enjeu,
ils
jouent
souvent
moins
bien,
et
échouent
au
bord
de
la
réussite.
Les
exemples
sont
malheureusement
nombreux,
au
point
que
les
adversaires
des
français
ont
souvent
en
tête cette capacité à échouer dans les grands moments, et ils en jouent.
Attention,
je
ne
crache
pas
sur
tout
le
sport
français.
Nous
avons
eu
et
avons
de
grands
champions.
Mais
nous
avons
traîné
pendant
de
longues
années
cette
culture
de
la
lose.
C’est
devenu
une
expression
commune
en
France.
La
culture
de
la
lose
c’est
cette
maladie
d’avoir
en
tête
tous
les
risques
et
d’oublier
complètement les opportunités.
Fin
Novembre
a
eu
lieu
la
finale
de
la
coupe
Davis
qui
opposait
la
France
et
le
Belgique.
Depuis
notre
dernière
victoire
en
2001
(16
ans
en
arrière
tout
de
même),
c’était
la
4
e
fois
que
nous
allions
en
finale.
Nous
avions
perdu
les
3
précédentes.
Pourtant
tous
les
spécialistes
étaient
unanimes
:
la
France
avait
sur
le
papier
l’équipe
idéale
pour
gagner.
On
parlait
même
de
nos
joueurs
de
l’époque
comme
de
la
génération
dorée.
Cette
satanée
culture
de
la
lose
avait
pris
le
dessus,
la
pression
devenait
trop
grande
et
ces
joueurs
réputés
talentueux
ont
échoué
à
soulever
le
saladier
d’argent
par
3
reprises.
On
imagine
donc
très
bien
que
pour
cette
finale
de
2017,
les
joueurs
ne
sont
pas
arrivés
sur
le
terrain
avec
la
conviction forte de pouvoir gagner mais avec en tête le poids de toutes les défaites précédentes.
Pour
ceux
qui
ne
connaissent
pas
le
fonctionnement
d’une
rencontre
de
coupe
Davis,
un
petit
rappel
:
deux
nations
s’affrontent
(en
l’occurrence
pour
cette
finale
la
France
et
la
Belgique),
et
on
joue
au
meilleur
des
5
matchs.
Chaque
match
remporté
vaut
un
point
pour
l’équipe.
Chaque
pays
aligne
4
joueurs
pour
les
3
jours
de
match.
Il
y
a
2
simples
le
vendredi,
1
double
le
samedi,
et
2
simple
le
dimanche.
Les
français
sont
passés
par
toutes
les
émotions
en
cette
finale,
et
nous
spectateurs
aussi.
Le
dimanche,
à
2
partout,
la
tension
était
à
son
maximum
:
le
dernier
match
allait
déterminer
qui
serait
le
grand
gagnant.
Les
journalistes
vous
ressortent
dans
ces
moments-là
tout
un
tas
de
statistiques
qui
sont
plus
ou
moins
pertinentes
mais
qui
ont
toutes
le
même
effet
:
elles
font
réfléchir,
et
même
trop
réfléchir.
Le
fameux
«
et
si
?
».
Pour
ce
match,
les
journalistes
nous
annonçaient
que
notre
adversaire
belge,
Steve
Darcis,
avait
dans
toute
sa
carrière
joué
cinq
5
ème
match
de
coupe
Davis,
et
qu’il
les
avait
tous
gagnés.
De
l’autre
côté,
les
français
avaient
perdu
leurs
3
dernières
finales.
On
n’y
croyait
plus
à
cette
victoire
2017.
Et
finalement,
Lucas
Pouille
notre
plus
jeune
tennisman
tricolore
a
triomphé.
La
délivrance.
On
a
enfin
prouvé au reste du monde que nous étions à craindre et que l’on peut encore gagner.
Il
faut
remercier
pour
ce
saladier
d’argent
(le
nom
de
la
coupe
reçue
par
les
vainqueurs
de
la
coupe
Davis)
le
capitaine
Yannick
Noah.
Que
l’on
aime
ou
non
son
style,
il
est
indéniable
qu’il
a
toujours
su
insuffler
à
nos
joueurs
la
rage
de
vaincre
et
la
conviction
qu’on
pouvait
gagner.
Mais
il
faut
peut-être
aussi
remercier
le
nouveau
président
de
la
fédération
française
de
tennis,
Bernard
Giudicelli,
qui
dès
son
arrivée
au
poste
a
annoncé
clairement
que
le
tennis
français
ne
se
satisferait
plus
des
défaites,
qu’il
était
inconcevable
de
penser
comme
ça,
et
que
sera
dorénavant
inculquée
dans
les
écoles
de
tennis
la
culture
de la gagne. J’ai hâte de voir le résultat en dehors de la coupe Davis.
Si
je
parle
de
ce
sujet
sous
l’angle
du
tennis
c’est
certes
parce
que
je
suis
un
grand
fan
de
ce
sport
(je
pense
que
ça
n’aura
pas
échappé
à
grand
monde)
mais
aussi
parce
que
je
le
transpose
au
monde
de
l’entreprise
en
France
qui
souffre
aussi
de
cette
culture
de
la
lose.
Non
pas
que
les
entreprises
françaises
ne
soient
pas
performantes,
mais
elles
ont
cette
façon
d’avancer
où
chaque
petit
pas
en
avant
est
préalablement
analysé
sous
toutes
ses
coutures
pour
être
sûr
qu’il
n’y
ait
pas
le
moindre
risque.
Ce
poids-là,
c’est
ce
qui
fait
que
les
entreprises
françaises
ne
sont
pas
les
championnes
de
l’innovation
et
qu’elles
n’évoluent
pas
toujours
aussi
vite
qu’elles
le
devraient
pour
s’adapter
aux
attentes
des
clients
(j’en sais quelque chose, je travaille depuis un an et demi pour la SNCF).
Tout
n’est
pas
noir
pour
autant.
Poussées
par
le
vent
des
start-up
qui
souffle
de
plus
en
plus
fort
en
France,
les
grandes
entreprises
sont
rentrées
depuis
peu
en
rupture
avec
leurs
méthodes
traditionnelles.
Elles
créent
toutes
des
laboratoires
d’innovation,
rachètent
des
start-up,
qui
ont
cette
culture
de
la
gagne.
Et
paradoxalement,
cela
passe
par
l’échec.
Ils
expérimentent,
ratent
des
choses,
mais
au
final
ils
innovent
:
le
fameux
apprentissage
par
l’erreur.
Ce
renouveau
des
mentalités,
qui
est
comme
toujours
déjà
la
norme
aux
Etats-Unis
depuis
quelques
années,
s’est
désormais
installé
en
Europe.
Et
c’est
très
excitant.
On
sent
que
le
champ
des
possibles
s’est
ouvert,
il
ne
tient
qu’à
nous
de
nous
lancer
et
d’innover.